L’article ci-dessous a paru dans le journal Le Monde il y a quelques jours. Malicieusement (!) intitulé “PS, digérer le vinaigre de Reims”, il est le fruit d’un entretien entre Gérard Grunberg (politologue, spécialiste du Parti socialiste) et Alain Bergounioux (historien, membre du PS et ex-secrétaire national aux études, soutien de Bertrand Delanoë lors du Congrès de Reims).
Ces deux observateurs avisés du Parti socialiste mettent en perspective le Congrès de Reims et ses enseignements... L’occasion d’esquisser l’état des lieux d’un Parti socialiste qui apparaît, à bien des égards, à la croisée des chemins. Sont notamment abordées les questions suivantes : qu’a montré le Congrès de Reims sur les modes de fonctionnement actuels du PS, quels nouveaux défis a-t-il fait surgir dans ce domaine ? comment interpréter politiquement l’ “affrontement” Martine Aubry-Ségolène Royal, et l’échec de Bertrand Delanoë ? quelles perspectives d’avenir ? comment la “dramatisation” de la question des rapports avec le Modem s’explique-t-elle, et dans quelle mesure cette dramatisation apparaît-elle pertinente ? quel rapport le PS entretient-il avec l’élection présidentielle, et quels défis doit-il relever pour se mettre en situation de la gagner ?
(Les passages mis en gras l’ont été par moi, pour une lecture plus rapide.)
 PS, digérer le vinaigre de
PS, digérer le vinaigre de Reims
Le Parti socialiste a terminé l'année 2008 avec une nouvelle direction, mais sans avoir surmonté ses divisions. Peut-il, malgré tout, se rénover ?
Alain Bergounioux. L'enjeu majeur des prochains mois est de le stabiliser. Si on reste dans des stratégies d'empêchement, la rénovation ne se fera pas. Or elle est indispensable. Le PS a connu ces dernières années une période de "dépolitisation" qui l'a rendu vulnérable par rapport à la droite et par rapport à l'extrême gauche. Il doit refaire de la stratégie, échapper à la contradiction qui le fait osciller entre des postures idéologiques et une gestion pragmatique. Je reconnais que c'était plus simple du temps de François Mitterrand : il y avait des rapports de force établis, des motions homogènes, des militants plutôt légitimistes. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué. C'est pour cela qu'il faut refaire avant tout de la politique...
Gérard Grunberg. La situation du PS me paraît grave et son avenir incertain. Le "duel des dames" qui se joue entre Martine Aubry et Ségolène Royal peut conduire, s'il n'est pas maîtrisé, à un affaiblissement réel de ce parti, voire, à terme, à son implosion. C'est l'élection présidentielle qui mine le PS. S'il refuse de résoudre sereinement la question de la présidentialisation, de sa logique et de ses contraintes, il peut décliner. Il doit se donner toutes les chances d'être présent au second tour de la prochaine élection présidentielle. S'il n'en fait pas son objectif premier, c'est sa survie même comme grand parti de gouvernement qui sera menacée.
Quelles leçons tirez-vous du congrès de Reims qui s'est tenu en novembre 2008 ?
A. B. Historiquement, ce congrès n'a pas vraiment d'équivalent. Comme à Rennes en 1990, aucune motion n'était majoritaire. Mais la grande différence c'est que, depuis 1995, le premier secrétaire est élu par l'ensemble des militants : si aucune majorité ne se dégage au congrès, c'est son élection qui devient le vote-clé. La logique de la présidentialisation a modifié les pratiques et les représentations du parti.
G. G. Ce congrès a fait éclater la contradiction entre les deux logiques à l'oeuvre dans le parti depuis sa création à Epinay en juin 1971. D'un côté, le principe de la représentation proportionnelle des motions dans les instances dirigeantes et de la délibération collective pour définir la ligne politique. De l'autre, le principe de l'élection directe du leader par l'ensemble des adhérents dans une logique majoritaire empruntée au mode de scrutin présidentiel français. C'est ce système qui, s'appliquant pour la première fois dans toute son ampleur, a explosé à Reims. Compte tenu de la personnalisation croissante de la politique, il n'est plus possible de traiter de la question du leadership une fois seulement que les questions de fond sont résolues. Le congrès a échoué à définir une ligne politique puis à désigner un leader dont la légitimité puisse s'imposer à tous. Cet échec marque la fin du parti d'Epinay. Le PS est écartelé entre deux logiques contradictoires qui ont empêché un nouvel Epinay.
Le problème fondamental du PS, c'est son rapport aux institutions de la Ve République ?
G. G. C'est évident. Plus les socialistes sont absorbés par la logique de la présidentialisation et plus ils la condamnent. Ils continuent à ne pas assumer d'être un grand parti présidentiel et à refuser les institutions de la Ve République. A Reims, beaucoup voulaient empêcher que le nouveau leader soit un(e) présidentiable. A l'arrivée, ils en ont deux, dont l'opposition va structurer la vie interne du parti dans les années à venir.
A. B. La question de la personnalisation ne se pose pas qu'en France. Aucun parti n'échappe à ce phénomène. Aucun ne peut vraiment disjoindre la désignation de son leader de ses orientations de fond. Dans son fonctionnement interne, le PS touche du doigt la contradiction qu'il dénonce dans les institutions de la Ve République. La façon la plus simple de la surmonter serait qu'il désigne, comme le font les grands partis sociaux-démocrates, un leader en début de législature ou de mandat présidentiel et qu'il fasse en sorte que ce leader se présente aux élections. Quitte à en tirer les conséquences s'il échoue.
C'est le premier secrétaire qui devrait être, selon vous, le candidat naturel à l'élection présidentielle ?
A. B. La théorie selon laquelle il ne faut pas de "présidentiable" à la tête du PS est erronée. La seule question qui vaille est : la désignation de ce leader doit-elle être l'affaire exclusive des militants ou être confiée à un électorat plus large ? C'est une question difficile. La "primaire ouverte" aux sympathisants n'offre pas une garantie de succès, comme on l'a vu en Italie. En outre, elle contribue à diluer le parti alors que dans un régime parlementaire on a besoin de partis forts. Toute la difficulté est d'ouvrir le PS mais de préserver sa force et sa cohésion.
G. G. Il y a cependant de fortes raisons de confier à l'ensemble des sympathisants la désignation du candidat à l'élection présidentielle. D'abord et surtout, cette désignation est devenue pour le parti lui-même un enjeu trop lourd à gérer et comporte un risque trop élevé d'implosion de l'organisation. Il a intérêt à la déléguer à un corps électoral beaucoup plus large. En outre, une telle modification faciliterait la mobilisation derrière le candidat désigné et augmenterait sa légitimité. Enfin, comme l'ont montré les primaires américaines, elle peut favoriser l'ouverture du parti et le renouvellement de son cercle dirigeant. Cependant, il faut reconnaître les difficultés et les problèmes posés par une telle modification. Elle heurterait de plein fouet un parti dont la culture et le fonctionnement demeurent parlementaires au sein d'un régime qui lui aussi, malgré les apparences, demeure un régime largement parlementaire.
Idéologiquement, la bataille Aubry/Royal est-elle le prolongement de l'opposition, somme toute classique entre la première et la deuxième gauche ?
A. B. C'est plus compliqué que cela. Comme à chaque fois que son identité paraît en jeu, le PS se déporte sur sa gauche et renforce sa critique du capitalisme. C'est un réflexe génétique mais, sous l'effet de la crise économique, cette évolution est aussi perceptible dans les autres partis sociaux-démocrates européens. En outre, on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté une ligne plus sociale-libérale incarnée par Ségolène Royal et une autre plus à gauche conduite par Martine Aubry. Mme Royal a mélangé les registres, elle a peu repris les thèmes de sa campagne présidentielle, elle a mené une critique radicale du comportement des banques. Mme Aubry et ses alliés ont davantage insisté sur les valeurs de la gauche. Mais les principales motions du congrès de Reims ne sont pas si incompatibles quand on examine les propositions concrètes. C'est la raison pour laquelle il n'est pas sorti de ce congrès l'impression d'un grand affrontement idéologique. On avait plutôt affaire à un choc de cultures politiques et de personnalités.
G. G. Reims me fait cependant penser au congrès de Metz, en 1979. Certes, le clivage central n'est pas cette fois-ci de nature économique. Mais dans l'un et l'autre cas, la majorité du parti, pour battre politiquement sa minorité - hier rocardienne, aujourd'hui royaliste, hier sur l'économie de marché, aujourd'hui sur l'évolution du parti et les alliances -, a adopté des positions très clivantes qui peuvent gêner soit la conquête du pouvoir, soit son exercice.
Que traduit l'échec de Bertrand Delanoë ?
G. G. Il a été pris à contre-pied par la crise. Les mêmes qui, au PS, s'étaient ralliés au réformisme contenu dans la déclaration de principes du parti ont radicalisé leur discours. Lorsque Martine Aubry dit "il faut changer le système", on sent bien que ce parti a toujours un problème pour définir son rapport au capitalisme. Il a du mal à redéfinir son projet européen. Il ne parvient pas à penser la mondialisation de manière équilibrée. Il privilégie trop souvent les distinctions manichéennes.
A. B. Il est vrai que l'anti-libéralisme sert souvent de pensée facile au PS. C'est regrettable, car cela lui interdit de penser une réalité plus complexe. Contrairement à ce qu'il dit souvent, la droite française n'est pas que libérale.
S'unir ou non avec le centre, la querelle entre Royal et Aubry sur les alliances est-elle réelle ou montée de toutes pièces ?
A. B. C'est une question identitaire : le PS, à Epinay, s'est fondé sur l'idée du rassemblement de la gauche contre la droite. En même temps, le sujet prend des contours nouveaux, car les alliés traditionnels des socialistes sont affaiblis. Ils ne suffisent plus à faire une majorité. C'est cette question que le parti ne parvient pas à aborder de façon rationnelle. Il est tiraillé entre son "hyper-idéologie" au niveau national et son "hyper-pragmatisme" sur le terrain.
G. G. Paradoxalement, ce parti qui se veut parlementariste ne s'est jamais posé la question des alliances dans une optique parlementaire. Pour lui, la conception des alliances est idéologique plus que politique : il s'agit de réunifier la gauche plutôt que de trouver une majorité au Parlement. Ainsi, le rapport au PCF n'a jamais été conçu par les socialistes - à l'exception de François Mitterrand... - d'abord comme une alliance. C'était avant tout le moyen de réunifier la classe ouvrière, comme disait Léon Blum, d'effacer le congrès de Tours de 1920 qui avait vu la scission du Parti socialiste. Aujourd'hui encore, lorsque le PS appelle au rassemblement de toute la gauche et au rejet de l'alliance avec le MoDem, il agit au nom d'une vision plus idéologique que politique.
(Propos recueillis par Françoise Fressoz et Jean-Michel Normand.)












+redim.png)









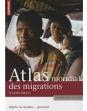

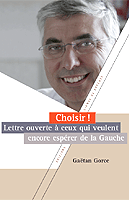
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire